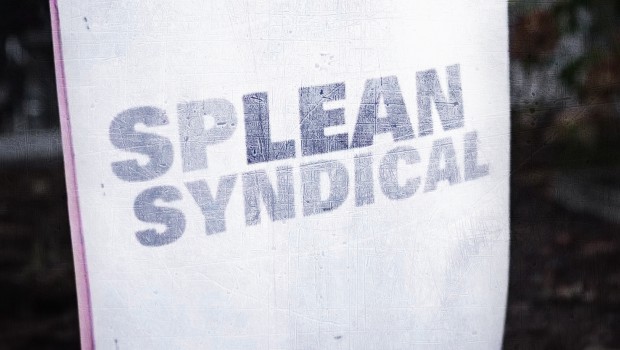Publié le 2 septembre 2014 | par Comité STAT
Le subterfuge des grands
par David Simard, ex-aide alimentaire
Pour qui n’a pas l’habitude de ce type de littérature, je ressens le besoin de formuler un commentaire introductif. Celui ou celle offensé par pareille méthode peut à sa guise sauter le présent paragraphe et, cela, sans m’en tenir rigueur. À la base, mon texte répond à l’éternelle question qui hante le ou la critique : que faire ? Que faire en tant que travailleur ou travailleuse contre un système de santé qui, dans sa forme actuelle, nous rend malades ? Et puisque nous sommes à l’aube de la prochaine négociation, quelle revendication pour mettre un terme au massacre, celui des patients comme le nôtre ? Il serait absurde de commencer la réflexion avec une réponse qu’à notre époque tous veulent entendre, vous savez, le fameux je ne sais pas, ruse socratique qui a mal vieilli. Alors j’ai décidé de présenter l’histoire de notre jeune organisation tout en dégageant un à un ses enseignements, exercice dont la difficulté est de ne jamais sauter aux conclusions. Je les réserverai pour la fin.
Le Comité de mobilisation de Verdun
Tout commence avec le Comité de mobilisation de Verdun. Petit, minuscule comité. Deux personnes. C’est le nombre qu’il faut au départ. À deux on peut discuter, proposer, décider et agir. Ariane et Ousmane ont voulu jaser avec leurs collègues de l’hôpital librement, sans égard pour leur appartenance syndicale ou leur profession particulière.
Discuter de quoi ? Des problèmes qu’ils partagent, ou non. Ils passent donc un tract et placent quelques affiches ici et là. D’étage en étage, en personne, ils livrent leur message. À l’ordre du jour : les conditions de travail difficiles, la pression psychologique exercée par les gestionnaires, la négociation en cours, sans oublier tout sujet jugé pertinent par les collègues qui les gratifieraient de leur présence.
Trois travailleurs se pointent. Hourra !
À ce nombre s’ajoutent trois représentants syndicaux. Deux d’entre eux restent debout malgré les sièges vides, surplombant l’assistance de leurs obliques sourcils. Sans plus attendre, sans même écouter quoi que se soit ils imposent leur propre agenda : « Que se passe-t-il ici ? C’est nous qui avons le monopole de la représentation des travailleurs. N’avez-vous pas conscience du point 1 de la convention collective ? Vous n’avez aucune légitimité pour entreprendre des moyens de pression. »
La naïveté de nos deux camarades qui pensaient banale une telle réunion se heurte de plein fouet à la réalité. Toute la réunion est un cirque, car, interrogés à revers par des représentants mécontents que leur autorité soit remise en question, nos deux amis, pris en étau entre le mépris et les ultimatums, n’arrivent ni à calmer les esprits, ni à entreprendre une saine discussion. Toute cette violence des syndicalistes dirigée contre leurs membres en disait long sur les rapports difficiles entre eux. En s’en prenant à leur initiative, ils s’attaquaient à la même liberté d’association pour laquelle, au début du siècle, nombre de syndicalistes sont morts. Mais maintenant qu’ils la possèdent, cette liberté, surprise, ils la confisquent de peur de la perdre.
Le lendemain, c’est l’administration de l’hôpital qui contacte le Comité par téléphone : vous ne pouvez vous réunir à l’hôpital, seul le syndicat le peut conformément au Code du travail. Et oust !
Notre lutte se poursuivait ailleurs. À un niveau supérieur, pensait-on : dans le cadre de la négociation de la convention collective du secteur public, celle de 2010. Un tract du Comité appelant à refuser les offres du gouvernement circulait. Après une assemblée plus que décevante et des mots d’ordre sans effet, Ariane et Ousmane décident d’agir. Ils écrivent un nouveau texte sur l’état lamentable du syndicalisme en vue de le distribuer aux représentants syndicaux de la FIQ rassemblés en congrès à Saint-Hyacinthe, question de voir s’ils seraient sensibles à leurs remontrances.
Personne ne les attendait en ces lieux, parce que figurez-vous que personne ne fréquente en temps normal les instances syndicales. Cette ghettoïsation ne semblait guère attrister les élus, car tout de suite après une escarmouche avec des goons, nos amis furent exclus de la salle sous prétexte que la confidentialité des informations transmises pourrait être compromise. On leur a même affirmé que, de toute façon, une demande préalable pour obtenir la permission de participer au congrès leur aurait été refusée.
Genèse de STAT
Je disais que les membres du Comité de mobilisation envisageaient dès sa genèse de s’organiser en vue de la prochaine négociation. Seul problème : la structure du Comité ne permettait pas l’adhésion de membres qui ne bossaient pas à Verdun. Étant donné qu’un membre appartenant à une autre institution voulait justement rejoindre les rangs du Comité, la nécessité de fonder un nouvel organe s’est fait ressentir. Un troisième membre pour le comité, à savoir moi, David, votre humble éditeur contre Goliath.
STAT, pour urgence. On la ressentait jusque dans nos orteils.
On a vu les syndicats former ce qu’ils appellent un « front commun ». Tout de suite je vous le dis : il n’y a pas d’appellation contrôlée en ce domaine. Rien à voir avec celui de 1972. Ils ont abandonné la lutte avant même de l’avoir entamée : aucun mandat de grève, de rarissimes et désertiques manifestations, mais surtout, et j’insiste, pratiquement le statu quo quant aux revendications sauf quelques points de détail, comme par exemple de maigres augmentations salariales, qui allaient invariablement nous appauvrir à cause de l’inflation, et même une hypothétique, exceptionnelle idée par ailleurs tant vantée par les relationnistes industriels des centrales à l’effet que notre salaire fluctue en fonction du PIB, moyennant, bien sûr, une croissance au-delà de toutes les prédictions expertes. Les plus zélés ont même dit qu’il s’agissait là d’une revendication historique du mouvement syndical, lesquels aspiraient semble-t-il à pareille soumission à l’économie marchande depuis belle lurette.
Je me rappelle lorsque mes représentants syndicaux sont débarqués en assemblée avec des propositions ridicules, armés de leur Powerpoint aux milles fioritures ronflantes. Ils ont dit après leurs monologues, lorsque tout le monde cognait des clous dans la salle : « vaut mieux les accepter, rappelez-vous que la dernière fois elles nous furent imposées par décret nos conditions. » Ça a pas passé. Le monde était en colère. Les critiques contre le syndicat fusaient. Dans chaque corps de métier, chacun rappelait ses revendications insatisfaites, comme toujours. Et on a voté contre.
Mais la joie fut de courte durée. Tout ça était symbolique, voire pathétique parce qu’à la fin, dans une centrale on l’a vite compris, même si tu votes contre les offres au local, c’est toujours les bureaucrates qu’on voit jamais sur les planchers qui décident la suite. Plutôt que de contester la proposition de la centrale sur la base de notre refus, l’exécutif s’est fait petit au congrès suivant tellement il avait honte d’avoir échoué à la faire adopter.
Quelques jours après la signature des conventions, on apprenait dans les journaux que le ministre des finances était prêt à concéder beaucoup plus, soit 2 % d’augmentation de salaire par année, ce qui représentait pratiquement le double de ce qui avait été accepté par les centrales. Notre cher ministre anticipait donc au lendemain de la négociation un surplus de 1,4 milliard. Il avait gagné sans avoir à lever le petit doigt dès l’instant où ses adversaires syndicaux, aujourd’hui fiers partenaires de la business nationale, avaient gobé l’argumentaire du gouvernement aux prises avec une crise économique d’une ampleur incommensurable, avec laquelle tous devaient conjuguer. La pire depuis 1929. Les syndicats n’avaient guère ruminé devant une si belle rhétorique et, cela, en dépit qu’ils faisaient face à leur ennemi juré, le Parti libéral.
L’absurdité d’une solidarité syndicale dans un tel contexte fut confirmée par le mensonge du front commun, avec la FIQ comme emblème. Elle se désolidarisa à la première occasion en raison de sa position stratégique dans la négociation, position adoptée suite à la nouvelle division du travail qui fait des infirmières des donneuses d’ordres, c’est-à-dire que les soins sont maintenant peu à peu dispensés par des subalternes. La FIQ accepta l’offre globale, ce qui sauva la face du front peut-être, mais elle négocia tout de suite après pour elle-même à la table sectorielle une juteuse augmentation salariale sous forme de primes.
Condition critique, notre journal
Je n’ai pas dit encore un mot sur les principes qui guident notre action. Au départ, la simple unité qu’assurait la conviction partagée que nous faisions face à une dégradation rapide et radicale de nos conditions de travail suffisait.
Avec notre premier journal, on est vite passé d’un groupe purement expérimental à une organisation sérieuse. Incapables de tout faire, nous voulions lancer une invitation à d’éventuels collaborateurs écrivains : on a dû clarifier notre ligne éditoriale, préciser notre stratégie et nos manières. Nous voulions entretenir un dialogue avec les travailleurs désillusionnés qui fuient la politique et comprendre leur ressentiment envers les syndicats.
Depuis le début nous sommes persuadés qu’il n’y a que vous, travailleurs et travailleuses, qui pouvez changer l’ordre des choses. C’est vous qui pouvez mettre un terme à tout ça. C’est vous qui connaissez le plancher mieux que quiconque et c’est vous qui avez le pouvoir de tout bouleverser. La vie au grand complet si ça vous chante. Rien dans ce monde ne vous est étranger. Vous en êtes les producteurs et il ne vous manque pratiquement que la conscience de cette centralité pour faire vôtres les plus folles ambitions. Non, je ne rigole pas.
Mais cette confiance en vous coûte cher : si vous êtes l’épicentre du changement possible, vous êtes de facto – immédiatement et nécessairement – les responsables de votre misère. Oui, je l’avoue, l’immaturité des travailleurs saute aux yeux. Perdre de vue toute la dureté de notre quotidien au travail avec vous, ces ressentiments, mensonges et trahisons vécus sur le plancher, ça serait contre-productif. Les coups bas qu’on se distribue sur une base régulière témoignent à n’en point douter de la survivance d’une morale de primates affamés. Je pense ici en guise d’exemple à cette collègue que je respecte tant mais qui, ne trouvant rien en dessous d’elle pour se défouler, prend sa revanche sur les noirs, les placoteuses et les assistés sociaux.
Depuis le début nous sommes persuadés qu’il n’y a que vous, travailleurs et travailleuses, qui pouvez changer l’ordre des choses. C’est vous qui pouvez mettre un terme à tout ça. C’est vous qui connaissez le plancher mieux que quiconque et c’est vous qui avez le pouvoir de tout bouleverser. La vie au grand complet si ça vous chante. Rien dans ce monde ne vous est étranger. Vous en êtes les producteurs et il ne vous manque pratiquement que la conscience de cette centralité pour faire vôtres les plus folles ambitions. Non, je ne rigole pas.
Alors, si personne à part vous ne peut enrayer les fléaux du travail moderne, mais que ce sont ces mêmes fléaux qui vous ont abrutis, voici l’épineuse question : quelle est notre rôle à nous, membres de STAT ? Nous pourrions fort bien devenir délégués syndicaux. Voire nous impliquer dans un parti politique. Puisqu’on est mieux que vous. Eh bien non ! Ce refus d’intégrer les structures faussement démocratiques a été longuement réfléchi : cette pratique ferait de nous des dirigeants et reconduirait la hiérarchie jusque dans notre organisation. En pleine conscience de cela, je vous le dis, aucune élite ne peut assumer les tâches qui sont à l’échelle de l’humanité et d’elle seule.
Je vous entends déjà vous plaindre de la radicalité d’une telle position. Rêveurs ! Idéalistes ! Révolutionnaires ! Soit. L’important c’est que nous refusons d’être payés pour notre travail politique comme Socrate refusait jadis de monnayer ses leçons de philosophie. Nous restons sur le plancher. La voici, notre p’tite révolution : mettre en branle dans les lieux de travail un dialogue avec nos collègues en vue de fonder avec eux, si possible, un comité démocratique et autonome. Autonome dans le sens de « qui se dirige lui-même, qui n’obéit qu’à lui-même. » C’est ça, l’auto-organisation. De la simplicité de cette pratique émerge son contraire, à commencer par les forces antagonistes, les boss, les comptables et les lèche-culs réunis.
Si pour mille et une raisons, et des bonnes à part de ça, nous ne parvenons pas à le former, ce comité démocratique, notre engagement envers vous, notre écoute et notre compassion, resteront indéfectibles. Voilà notre engagement, enfin, jusqu’à ce que nous atteignions notre burn-out, la seule option qu’il nous restera une fois nos espoirs broyés par la dure réalité du travail.
Le Comité STAT rassemble des travailleurs et des travailleuses qui promeuvent cette perspective et veulent s’organiser pour lui donner vie. Nous appliquons l’autonomie à petite échelle comme s’il s’agissait là d’un test. Nous travaillons à construire notre organisation et sa théorie critique en respectant au mieux les désirs et limitations de chacun et chacune. Le Comité STAT n’est qu’un organe de réflexion et de travail politique alors que l’action révolutionnaire, elle, appartient en définitive aux travailleurs eux-mêmes et se présentera plus concrètement le jour où ils prendront en main leur destin. Il se peut que ce jour ne vienne jamais.
Contre le Lean
Après le journal, nous sommes revenus motivés à la planche à dessin avec en bonus deux nouveaux membres qui savaient faire bon usage de leur plume acérée. Désormais, nous existions socialement. Mais que faire ?
C’est le ministre Bolduc lui-même qui a répondu. Le pauvre n’avait qu’un mot dans la bouche : Lean. En lançant sa campagne d’implantation de cette méthode, il disait voilà la solution miracle contre la pénurie de personnel et de ressources, l’augmentation des coûts et les listes d’attente.
Pas longtemps après, la réorganisation est arrivée chez moi, aux cuisines. Hier encore nous étions cinq à faire le travail et aujourd’hui sur le plancher, seulement quatre. Mais ça fonctionne pareil. La roue tourne. On n’arrive plus à la suivre, mais qu’importe, ça continue. Zéro délai, juste à temps, toujours en mouvement. Moins de déplacement, plus d’opérations. Pas de stockage, bonjour les rétroactions ! En mode automatique fonctionne ce corps brouetté qui poursuit avec une telle assiduité la marche du progrès, et sa tête, décorative, elle reste toujours en compagnie de la carcasse qui s’anime frénétiquement, une étrangère.
Pèse ainsi sur nous le poids des crises économiques. Pour les pallier, des rationalisations et des réorganisations auxquelles nous offrons notre concours. Tout ça est un seul et même cycle. Raclure, réorganisation. Coupure, optimisation. Impossible d’arrêter la procédure sans faire crever du monde à la pelle. Notre réorganisation impliquait la participation d’une poignée de travailleurs qui, de par leur expérience et le respect dont ils jouissaient, légitimaient les décisions venues d’en haut sans même en saisir toutes les conséquences. C’est sans parler de la contribution des syndicalistes passés maîtres pour hocher la tête à chaque nouvelle idée de la boss.
Alors c’est ça, l’avenir : des gestionnaires, des syndicalistes et des travailleurs main dans la main, parlant un même langage, créant des focus groups dont l’objectif est de chambouler notre travail à coup de sermons sur la qualité des services. Lire : intensifier toujours notre besogne.
Une deuxième vague de compressions est survenue lorsque le PQ a pris le pouvoir. 100 millions de coupures supplémentaires dans les CSSS, rien de moins. Changement de ministre, changement de vocabulaire : du Lean nous sommes passés à l’optimisation. Une tuerie. L’exemple parfait est sans conteste Bordeaux-Cartierville. Là-bas près de 80 postes ont dû être coupés par l’administration afin de respecter l’équilibre budgétaire. Les syndicats ont répondu : « nous n’avons guère le choix d’obtempérer avec résilience et bonne volonté. Ce à quoi nous sommes déjà accoutumés. » Puis ils ont lancé le mot d’ordre complètement déconnecté : « respecter un rythme de travail normal en n’oubliant pas de prendre toutes les pauses santés auxquelles nous avons droit. » C’est une blague ? Personne ne va laisser les patients dans leur merde pour faire respecter ses droits. Le président de la FTQ, Michel Arsenault, a quant à lui conclu le simulacre d’indignation en disant « que les coupures que madame Marois devait faire sont faites et qu’il n’y en aurait pas de nouvelles. […] Ce n’est pas une mauvaise nouvelle en soi. »
Je vous fais grâce des réorganisations qu’ont vécues tous les autres membres du groupe. Tout le monde y a goûté.
Il fallait vite étudier les transformations du travail et comprendre pourquoi aucune contestation n’éclatait. Devant l’absence de position claire contre le Lean chez les syndicats, nous nous sommes attelés à la tâche. Il a fallu un an pour rédiger notre petite brochure. L’étude du Lean nous a fourni une vision nette à la fois des transformations du travail qui s’opèrent à l’échelle mondiale que de celles plus vicieuses au local.
La gauche aime bien nous parler du néolibéralisme quand vient le temps d’expliquer cette ère de défaites dans laquelle nous sommes plongés. Elle regarde de si haut la réalité qu’elle en occulte le quotidien. Peu rappellent à quel point le travail à été maintes fois réorganisé en notre défaveur dans les dernières décennies et comment les syndicats y ont participé. Très peu avouent que ces réorganisations ont durablement transformé le travail au point de le rendre moins pénible, du moins physiquement, et que cela a eu pour effet d’anéantir le rapport de force syndical autrefois basé sur les griefs. Et très, très peu parlent du sentiment de reconnaissance que procure aux travailleurs leur participation à l’amélioration des processus de production, phénomène auquel participent les nouvelles stratégies de gestion qui évitent le recours à l’autorité en responsabilisant les travailleurs quant à la qualité et à l’importance de leur travail socialement parlant. Et rappelez-vous : la porte est toujours ouverte ! Ainsi s’efface la ligne de démarcation entre exécutant et décideur jusqu’à faire oublier aux travailleurs leurs intérêts divergeants. Ainsi s’effrite la puissance syndicale.
Il est vrai, par contre, qu’à ces changements correspond une politique économique à laquelle les centrales syndicales ont d’ailleurs adhéré en 1996 lors du Sommet socio-économique. Polyvalence, compétitivité, déficit zéro, qualité totale et virage ambulatoire, à toute ces merdes dites inéluctables ils ont dit oui. Et pourquoi ? En échange d’un pouvoir, celui de participer aux réorganisations. Ils en rêvaient. Faire un pacte avec le diable était une occasion de reprendre la bataille sur le terrain de l’organisation du travail, cette bataille qu’ils ont délaissée une fois gagné le monopole de la représentation des travailleurs et la négociation des salaires à une table centrale. Cette victoire est amère puisqu’elle implique la fin des hostilités entre les périodes de négociation et le respect du droit de gérance, de sorte qu’avec le temps, les syndicalistes, n’essuyant plus que des défaites au local jusqu’à perdre leur attrait, ont voulu trouver une solution. Seulement, jamais la reconnaissance des syndicats et de leur expertise dans les processus de réorganisation, dont parlent les textes du Sommet, n’a été accompagnée d’un quelconque pouvoir décisionnel.
En mode automatique fonctionne ce corps brouetté qui poursuit avec une telle assiduité la marche du progrès, et sa tête, décorative, elle reste toujours en compagnie de la carcasse qui s’anime frénétiquement, une étrangère.
Pour la suite du monde
Nous n’ignorons pas que la puissance syndicale s’est d’abord constituée autour du travail, par les liens solides qu’entretenaient au quotidien ses militants avec les travailleurs. À une certaine époque pas si lointaine, être un syndicaliste, c’était travailler fort comme tout le monde à l’usine en plus de mener une politique de contestation en parallèle, au travail et à l’extérieur. On les tenait en estime, et pour cause. Mais en quittant les lieux du travail en vertu de la même spécialisation dans tous les secteurs de la production, les intérêts des représentants sont devenus peu à peu étrangers, puis opposés à ceux de leurs membres, d’où leur comportement acritique et violent dès qu’une organisation comme la nôtre remet en question leur façon de faire.
Une fois aux quatre ans, les centrales négocient notre force de travail par catégorie d’emploi en package deal. Pareil aux dirigeants d’une entreprise de ressources premières, ils administrent fermement la main-d’œuvre, la manipulent et étudient sa valeur sur le marché pour en faire la publicité et la faire fructifier. Merci à vous ! Nous apprendrons par voie de communiqué, que dis-je, pardonnez-moi, nous lirons au détour d’un corridor austère sur de petites affichettes sans style le résultat de cette liquidation. Y figurera au centime près notre valeur sur le marché international. Le pouvoir des syndicats, leur statut et leurs revenus, tous infiniment supérieurs à celui d’un simple travailleur, dépendent du marché et de rien d’autre, ce qui assure en dernière analyse leur intégration et leur soumission.
Les contrats de travail qui se négocient au zénith du pouvoir reconduisent et solidifient la division des travailleurs en corporations concurrentes. Elles enchâssent les différences de salaires et les préjugés reliés à chacune des catégories d’emploi. La plupart des travailleurs, même les plus à plaindre, les plus pauvres et besogneux, estiment aujourd’hui naturelle et juste une telle hiérarchisation. De la même façon, bon nombre d’entre nous dénoncent avec véhémence la corruption et la ribambelle de profiteurs qui bafouent les règles, mais peu, très peu s’en prennent aux règles elles-mêmes, ces règles qui assurent la continuation de l’injustice par-delà les scandales occasionnels.
Bref, les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Une autre vague de compressions s’en vient. Suivront nécessairement de violentes réorganisations avec ses multiples gels d’embauche et coupures de postes. C’est dans ce contexte que nos braves dirigeants syndicaux négocieront en 2015 la convention collective du secteur public. Ça sera l’occasion à n’en point douter d’une énième chicane de salaire où s’entre-déchireront une trâlée de mercenaires pour de minimes pourcentages supplémentaires. C’est à grand renfort de publicité que toutes ces réorganisations seront vite oubliées, et les prochaines de surcroît avalisées. N’importe quel avancement salarial consenti sera compensé a posteriori par des mises à pied ou des réorganisations successives d’une intensité foudroyante. Et cette pression sera doublée par l’inflation qui vient inexorablement gruger notre pouvoir d’achat.
Donc, en respectant la trame habituelle, on perd.
Certes, il y a sursaut de politique pendant les négos, mais de quelle politique ? Celle de la défaite. Du spectacle. Des permanents syndicaux qui vont prendre l’air devant les kodaks. De l’argent, des chiffres et des compromis larvés. Plus personne n’y croit. Ni les politiciens, ni les journalistes, ni toi, ni moi. Personne. Combien de défaites avons-nous ainsi essuyées et combien en faudra-t-il encore pour tout remettre en question ? En exigeant quelques dollars de plus, on accepte le principe comme quoi l’argent est le seul langage universel qui puisse rassembler tout le monde. On éclipse de la sorte l’extrême complexité de notre travail et des problèmes que nous y rencontrons. C’est le chemin inverse que se propose de prendre STAT.
L’auto-organisation exige une posture si solide qu’aucun raccourci ne soit possible. On changera pas la vie sans un long et ardu travail de réflexion, et, chemin faisant, de pratiques contestataires intelligentes et démocratiques. L’éclipse de la mémoire qu’engendrent ces transformations du travail qui se chevauchent à toute vitesse constitue un danger imminent. Notre proposition est donc d’une part de continuer notre campagne contre les réorganisations, en produisant ce journal ou en portant assistance à des travailleurs en lutte au local par exemple, et d’autre part d’historiciser celles d’hier et d’aujourd’hui, ce qui exige au préalable de rentrer en contact avec des travailleurs qui veulent en témoigner. L’essentiel de notre plan de match est là.
Les syndicats, oui, ont des structures dont nous pourrions tirer avantage. Mais il y a un mais. Ils ont déjà tout décidé pour nous. Tout. Les assemblées ne sont plus que des parodies de démocratie où la parole individuelle est factice. Elles n’en restent pas moins le seul espace où nous pouvons affronter la hiérarchie syndicale. C’est pourquoi nous y ferons figure d’opposition. Avec de la chance et de belles propositions, qui sait. Nous sommes persuadés que la hantise générée par toutes ces réorganisations s’enchaînant à un rythme effréné constitue la revendication latente la plus populaire qui soit. Hélas, à date, la lutte contre les réorganisations échappe à toute formulation par les syndicats. Il faudra donc recommencer du début et formuler des revendications qui soient véritablement issues de la volonté des travailleurs. La tâche est des plus difficiles sans espace ni moyens financiers.
De l’argent, des chiffres et des compromis larvés. Plus personne n’y croit. Ni les politiciens, ni les journalistes, ni toi, ni moi. Personne. Combien de défaites avons-nous ainsi essuyées et combien en faudra-t-il encore pour tout remettre en question ?
La lutte revendicative reste pertinente si et seulement si elle appartient radicalement à des travailleurs en lutte qui exigent leur dû. Tout commence par le refus de participer à l’intensification du travail. Car si intensification il y a, les fruits doivent être partagés, et non pas servir à moult coupures. On peut certes rire des syndicats tel que l’APTS – pour n’en nommer qu’un seul – qui participent un jour aux réorganisations et claquent la porte en se disant dupés le lendemain, cela, une fois les coupures annoncées et leur savoir partagé avec l’employeur. Le sous-financement chronique du réseau s’explique par un système économique qui stresse toutes ses composantes pour augmenter la productivité. Il n’y a donc aucun moyen de mener la lutte sans prendre en compte notre situation particulière dans le monde et appeler à pareille contestation dans tous les domaines de l’économie. La chaîne de montage est mondiale et nous sommes en lutte contre ceux qui jouent à ce jeu qu’on appelle capitalisme.
L’organisation du travail est la question politique par excellence. Elle nécessite l’unité des travailleurs de tous les corps de métier et la coopération entre eux jusqu’à la gestion commune de la production. Il faut prendre conscience du rôle de chacun, respecter ce rôle et parler d’égal à égal malgré les inégalités. À la base, comme de vrais communistes, disons-le, nous pensons que celui qui commande la production commande en dernière analyse à la fois la politique et la société. L’émancipation des travailleurs et des travailleuses passe donc par une prise en charge de la production, avec une structure unitaire respectant l’égalité de tout un chacun. À partir de là, impossible de simplement voter pour ensuite retourner faire ses petites affaires. Non, il faut de par notre action quotidienne rendre foncièrement inutile le travail parasitaire des bureaucraties gouvernementales, syndicales et patronales. C’est ainsi que la surcharge qui nous est attribuée pourrait fondre comme neige au soleil. Mais inutile de vous cacher que, pour s’affranchir, ça demande beaucoup de travail, lequel apporte son lot d’insatisfactions.
À vous de voir.
Pour accéder à l’intégral du journal Condition Critique 2014